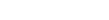Quels mouvements font œuvre de résistance ? La question est au cœur de la pièce One hundred more, présentée à l’Agora. La réponse commence, pour les cocréatrices et interprètes Justine A. Chambers et Laurie Young, par le simple fait de se mettre en scène, comme femmes de couleur — mères et danseuses. Le livre The Minor Gesture, qui les a beaucoup inspirées, offre aussi des éléments de réponse. Entretien avec son auteure, la professeure de Concordia Erin Manning.
Une définition impossible
Je joins Erin Manning à Rio, via Zoom, après avoir lu des passages du livre, et vécu quelques moments d’illumination me rappelant mon credo d’étudiante en philosophie (« La danse, c’est de la philosophie en mouvement »). Mais je n’arrive toujours pas à définir le geste mineur. Je vais donc droit au but. Qu’est-ce que le geste mineur ? « Le geste mineur se fait, ce n’est pas quelque chose qui se définit, il n’y pas un geste mineur général… C’est une variation qui se propose, qui offre une autre façon de comprendre ce qui se passe autour de nous et ce qu’on fait. »
Erin Manning arrête là l’impossible définition. Elle préfère raconter comment elle en est arrivée à le nommer — et à rédiger tout un essai autour du geste mineur. Et elle commence par affirmer le fait qu’elle est d’abord une danseuse. « Tous mes concepts viennent du mouvement. Il y a quelque chose d’intuitif dans la pratique philosophique, qui part du faire ». Le philosophe est un danseur, écrivait Nietszche. Une nuance importante qui ajoute une dimension au concept de « littérature mineure » développé à la base par les philosophes Gilles Deleuze et Guattari.

Ouvrir l’oeuvre à d’autres possibles
Le récit d’Erin Manning la ramène à son œuvre Slow Clothes, rebaptisée par la suite Stitching Time, chorégraphie atypique, « exposée » plusieurs fois depuis 2008. Inscrite dans une pratique de l’art relationnel, cette œuvre est constituée dans la durée, avec le public, à partir de 2000 morceaux de tissus cousus, pour former un vêtement ou une architecture, à la manière d’un patron infini. « La chorégraphie est immanente au processus.» À Sydney en 2012, elle décide même de donner aux participants les vêtements qu’ils ont créés. À Moscou, l’année suivante, elle frappe un mur.
« Les gens arrivent et je me sens comme dans un centre d’achat. Les gens font la file pour recevoir un habit gratuit, car ce sont des soies extraordinaires… C’était tout ce que j’imaginais que l’œuvre n’était pas. J’étais déprimée. Après cette expérience, j’ai compris que ce qui ne pouvait pas exister dans ce contexte-là, c’est ça, le geste mineur. Ce n’est pas un geste qu’on crée, on ne peut pas poser un geste mineur. Mais on peut créer les conditions ou ouvrir l’œuvre à la possibilité d’un geste mineur. C’est un geste qui résiste à l’enclos de l’œuvre, qui ouvre l’œuvre à quelque chose d’autre. »
Une force politique
On ne peut donc pas identifier, présenter des gestes qui seraient «mineurs». Comment alors en faire une chorégraphie ? La professeure de Concordia nous lance quand même une piste.
« Quand on est face à l’œuvre (chorégraphique), qu’on la ressent fortement, mais qu’on a pas les mots pour l’exprimer, on est en train de vivre le geste mineur. Quand le public dit : je ne comprends pas, je ne sais pas quoi regarder. Je leur réponds : laisse toi aller à la rencontre de ce processus, soit ouvert au geste mineur de l’œuvre. »
Le geste mineur résiste donc à la définition. Il est hautement subversif et donc forcément politique. Il y a une forme de contestation sous-jacente au thème du geste mineur. Contestation des courants dominants, de l’académisme, des perceptions – et gestes – neurotypiques. Une grande partie du livre d’Erin Manning traite d’ailleurs de l’autisme.
Un ancrage dans la pensée noire
« C’est forcément une pensée politique, dit-elle. Je parle aussi dans mon livre des grands gestes (grand gesture). C’est, par exemple, la manière coloniale dont on adresse la question autochtone. On tend à penser que ce sont eux qui forment le politique. Alors que c’est tout le contraire. Le politique se trouve dans les gestes mineurs. »
Même son choix d’écrire en anglais, alors que sa langue maternelle est le français, y est lié. « Il y a une façon de jouer avec la langue en anglais qui permet de refaire les phrases, où le sujet n’est pas le dominateur de la pensée. »
« Le geste mineur ne peut d’ailleurs pas être pensé en dehors du blackness », ajoute celle dont tous ses écrits traitent de près ou de loin de blackness (qu’elle trouve d’ailleurs impossible à traduire). Mais attention, prévient-elle : « le geste mineur – comme le blackness – n’est pas réductible à une identité. » Ce qu’on tend à confondre par les temps polarisés qui courent. « On pratique la whiteness, on n’est pas la whiteness ou le blackness. C’est ce que les chorégraphes [Justine et Laurie, avec qui elle s’est entretenue brièvement au début du processus de création], ont compris intuitivement. »

Une oeuvre nécessaire
À sa création initialement prévue en 2020 à l’Agora (reportée à cause de la pandémie), One hundred more a déjà une forte résonance politique. La pièce fait notamment écho aux mouvements en marche #BlackLivesMatter et #Meetoo. Deux ans plus tard, après George Floyd, après Joyce Echaquan, cette résonance s’est-elle amplifiée ? La pièce est-elle encore plus pertinente ?
Justine A. Chambers : La question est plutôt, selon moi : pour qui est-elle devenue plus pertinente ? Ce moment (après George Floyd et une résurgence de la haine anti-Asiatiques qui est profondément ancrée dans l’histoire canadienne – pensons à la taxe d’entrée, [ndlr: imposée en 1885 aux immigrants chinois]) nous a changées. Il a eu un impact sur notre relation au fait d’être des femmes racisées, parce que l’écheveau sociétal est différent. Certaines personnes sont plus conscientes et ouvertes. D’autres s’ouvrent et se ferment, tandis que le reste des gens demeure complètement hermétique à cette prise de conscience. Je présume que l’important est de faire cette danse, et de laisser tous les événements et les expériences incarnées au quotidien de se frayer un chemin au travers. Cette danse est un réceptacle pour l’autodétermination. S’autodéterminer et permettre la rencontre à travers cette pièce me semble essentiel.
Laurie Young : One hundred more a connu sa première à Berlin à la fin 2019 et c’était déjà un urgent plaidoyer. Depuis, la liste des incessantes violences raciales s’allonge douloureusement. Je pense que le fait d’être en pandémie et en confinement pendant George Floyd a exigé de s’asseoir et de réfléchir. C’était le temps des constats et maintenant, après deux ans, quelle résonance et responsabilité sont mis de l’avant et par qui ? La pandémie a suscité un regain de haine anti-Asiatique et cette confusion, comme le dit si bien Justine, me convainc que danser ensemble est et sera toujours pertinent.
Pour aller plus loin…
- Lire l’article du magazine Stir (en anglais) publié lors de la présentation du spectacle à Vancouver
- Lire l’entrevue avec Laurie Young (en anglais) sur le site du Dance Centre de Vancouver