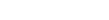Deux artistes d’origine colombienne rythment la saison à l’Agora de la danse : Andrea Peña et Lina Cruz. Et si leurs racines latino-américaines y étaient pour quelque chose ?
Andrea Peña, 30 ans, a compris seulement récemment que sa famille avait quitté la Colombie pour fuir les violences des cartels et les difficiles perspectives d’avenir. Lina Cruz, de 30 ans son aînée, sait depuis longtemps que c’est pour cette raison qu’elle est partie voir ailleurs…
Toutes deux livrent leur plus récente création à l’Agora cet automne. 6.58 : MANIFESTO d’Andrea Peña aborde le rapport ambigu des humains à l’artificialité. MORPHS de Lina Cruz met en scène des Êtres objets, acteurs de notre imaginaire. Elles partagent ici quelques mémoires et réflexions sur leur double (et parfois triple) appartenance culturelle et citoyenne. Sur les liens qu’il peut y avoir — ou qu’il n’y a plus — entre la création et la posture d’exister « entre » deux patries.


Quelles racines les relient à la Colombie ?
Andrea Peña est intarissable au sujet de son pays d’origine. Installée à (et amoureuse de) Montréal depuis 2013, elle retourne à Bogota chaque année voir sa famille élargie. Ses parents immédiats sont établis à Vancouver, où elle a vécu une dizaine d’années.
« Je suis plus Colombienne que Canadienne. Il y une posture très humble des Colombiens qui est en moi. C’est la vulnérabilité et l’épuisement des corps que je travaille aussi dans ma danse. Ça reflète le fait que l’être humain est toujours en lutte, en négociation d’une tension, avec la fragilité qui vient avec. On voit ça au quotidien dans la rue en Colombie. L’espace « entre » [deux appartenances culturelles] m’angoissait avant, mais c’est devenu une force. Le déplacement, ça influence la façon dont tu regardes les choses. »
Lina Cruz a presque coupé les ponts depuis l’âge de 13 ans, sauf quelques allers-retours pour voir son père. « Je dis souvent que j’ai trois vies: la colombienne, l’espagnole (où dès 16 ans j’ai fait ma formation de danseuse) et ici, ma troisième vie, la plus longue et mature. Honnêtement c’est la Colombie qui est restée derrière parce que ça fait trop longtemps. »
Quelle mémoire du pays reste prégnante?
Celle de Lina en est tristement une de misère et de souffrance, même si elle reconnaît que la situation a beaucoup changé aujourd’hui. « C’était une époque de gamines, ces enfants qui dormaient dans la rue et n’avaient rien », raconte Lina Cruz. Elle admet qu’elle ne se sentait pas la force de changer les choses à l’époque. Elle ne souhaitait pas vivre là où prendre un simple bus était dangereux.
Andrea est habitée par le présence de son abuelo (grand-père) Miguel, mort il y a 10 ans. La famille commence à retracer ses origines autochtones, encore dénigrées en Colombie. «C’était un humaniste, il portait la sagesse indigène en lui.»
Un objet ou une pratique qui fait partie de leur quotidien ou de leur imaginaire?
Les deux artistes peinent d’abord à identifier ce qui les aurait suivies jusqu’ici. Lina Cruz évoque « les couleurs de la nature, si différentes d’ici, la profondeur du ciel et la diversité des fruits ! ». Andrea Peña déjeune encore fréquemment des arepas, ces galettes salées faites à base de maïs qu’on mange parfois avec des œufs. Le commerce Sabor Latina sur le boulevard Saint-Laurent fait partie de son parcours urbain.


Y a-t-il un imaginaire colombien commun? Le réalisme magique à la Garcia Marquez ?
Les deux artistes ont la Colombie dans les gènes, mais pas la même appartenance à ce que serait un imaginaire latino-américain. Lina Cruz insiste : « Garcia Marquez est unique mais il n’est pas nécessairement représentatif de la littérature colombienne ». Ni de son propre imaginaire. Même si elle reconnaît que les choses incroyables qu’il écrit – perçues comme un peu magiques – se passaient parfois vraiment dans les rues colombiennes…
Elle raconte tout de même une anecdote de ses 13 ans. Une grande tablée de brunch du dimanche chez une amie. Un monsieur qui parle beaucoup. Et la maman de son amie qui ne cesse de dire « Hey Gabo, por favor Gabo… » « J’étais fascinée, ma tête toujours tournée vers la droite pour l’écouter parler. Je savais que Garcia existait, mais je n’avais pas fait la connexion. J’ai compris ensuite qu’il avait fondé un journal avec le papa de mon amie… »
Andrea Peña croit que cet imaginaire opère dans son travail artistique – et dans celui de ses compatriote expatriés —, mais elle n’arrive pas à le nommer précisément. Quelque chose dans le frottement d’une matérialité des corps et de l’univers poétique parallèle qui s’en dégage malgré tout.
La clé des chants
Malgré leur rapport très différent à leur culture d’origine et leur style chorégraphique très distinct, un parfum de réalisme magique semble malgré tout traverser subtilement leur danse. Lina Cruz dira qu’il s’agit là de mon point de vue. Réalisme magique à la Garcia ou non, Andrea trouve urgent, comme artiste latino-américaine, de « développer un discours pour savoir identifier comment notre culture se reflète dans notre travail ».
Ce qu’elles ont indéniablement en partage, c’est l’énergie débordante de leur danse et leur rapport existentiel au chant, mis à l’honneur dans leur création. Andrea y voit la rythmique propre à sa culture natale. « Je chante toujours une chanson dans ma tête même quand le contexte ne s’y prête pas ». Lina Cruz explore le chant comme « une autre forme d’expression de l’être humain », dit-elle.
« On aime tous chanter, on a tous peur de chanter, mais ça fait du bien! » Lina Cruz
En réunissant les deux Colombiennes dans sa programmation, c’est cette magie toute simple de chanter et de danser viscéralement que l’Agora appelle de tous ses vœux. Pour célébrer un autre monde en cette saison encore un peu troublée par la pandémie…