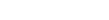Ces mots sont ceux de Mélanie Demers, créatrice fertile et pertinente. La chorégraphe a aussi une formidable plume, aussi poétique que percutante, que je tiens à partager avec vous. Livrées ici pêle-mêle, « à lire comme on ouvre un carnet de notes », comme elle insiste à le dire, ses pensées s’épanchent sur la création, sur l’ambiguïté d’un « nous » noir et l’urgence de le raconter malgré tout. Aux lendemains de la reprise de sa Goddam Voie Lactée, à la veille de présenter son Cabaret noir à l’Agora, et de refaire sa Confession publique au Festival TransAmériques, l’artiste nous invite à « une plongée dans [s]on labyrinthe de création ». La parole est à elle.
Frédérique Doyon
Avertissement : Il n’y aura pas d’avertissements
Vers ce spectacle, vous marchez. Nous y marchons tous, convaincus que l’œuvre n’est pas une doudou, un toutou, le sein d’une maman. Non. Si notre compte est bon. Si notre équation fonctionne. Si la chimie opère, ça fera boom. Et c’est tant mieux.
Nous ne vous avertirons pas des dérapages, des écueils, des dangers, des traumas que nous pourrions causer. Le spectacle est une réflexion, une intention, une épine dans le pied, une tentative voutée et imparfaite de nous dire, de nous raconter.
Mais Cabaret Noir n’est pas un spectacle sur les nègres. C’est un spectacle où les nègres regardent le monde.
C’est déjà ça de pris.
Qu’est-ce qui nous lie?
Au-delà de notre peau, qu’est-ce qui nous lie nous six et nous tous? Une histoire commune? La somme de toutes nos hontes? Milles stéréotypes passés au fer à repasser? Une désinvolture? Une posture? Une imposture? Une peur panique? Le poids du monde?
Ou peut-être rien du tout.
L’identité noire est un fantasme, une construction, une vue de l’esprit. Ce qui nous lie, c’est peut-être juste le besoin, le bonheur, l’envie.
« En me plongeant dans la création de Cabaret Noir, il m’est donné de réfléchir à nos héros, à leurs destins brisés, broyés, bouffés par la machine. De Malcolm X à Mohamed Ali, de Whitney à Billy Holliday, de Patrice Lumumba à Winnie Mandela… » — MÉLANIE DEMERS

Lettre à Toni Morrison
Si tu n’étais pas déjà morte, peut-être un jour serais-je allé te visiter. Je serais descendu du bus à Lorain, Ohio comme on arrive chez une grande tante qui ne se surprend ni de l’absence, ni de la présence des autres. J’aurais écouté ta voix granuleuse me raconter les pires tourments avec un sourire qui montre les dents. Et j’aurais savouré la complexité de tes histoires, toutes les ambiguïtés dépecées par tes bons soins et j’aurais pu boire à la source ce que je consomme maintenant en succédané. Par petites doses. Chaque livre donnant accès à une pensée puissante, profonde, magistrale.
Tu déposes sur le canevas de nos vies la honte, la haine, l’amour, la mort, la race, cette farce et tu tires et tu tisses sur les fils narratifs pour en créer des toiles qui réécrivent le monde. Réécrire le monde. C’est un pouvoir que j’aimerais avoir.
De l’ambiguïté d’aimer Michael Jackson
Il faut le dire. Il a du génie, une dégaine comme il ne s’en fera jamais plus, un sens musical inouï, une façon de bouger qui a marqué les esprits, un impact sur la culture populaire inégalé, un destin d’enfant star qui n’a jamais grandi, une vie interstellaire et une débâcle digne de la chute de l’Empire romain.
Ce jeune homme noir, sexy et fringant, mort en petite chose blanche, asexuée et fragile. On l’a vu se transformer sous nos yeux. Exit le nez épaté. Exit les lèvres charnues. Exit les cheveux frisés. Exit la peau mâtinée. Tout ce que j’ai essayé d’aimer chez moi, il se l’est effacé chez lui. Ce qu’il s’est arraché à lui-même, il me l’a arraché à moi aussi.
En créant ce monstre hideux, il a dépolitisé les enjeux. En se soustrayant de son corps intime, il nous a privés de nos avancées, de nos luttes, de nos progrès infimes. En chantant tout bonnement it doesn’t matter if you’re black or white, il nous a menti, démantelé, démantibulé.
Pourtant, même en pâle copie de lui-même, même en fantôme menaçant les enfants, même en mort-vivant, il continue de faire danser les popotins. Je ne sais jamais comment expliquer à mon fils de six ans toutes les ramifications de ses choix et des impacts sur nos vies.
En me plongeant dans la création de Cabaret Noir, il m’est donné de réfléchir à nos héros, à leurs destins brisés, broyés, bouffés par la machine. De Malcolm X à Mohamed Ali, de Whitney à Billy Holliday, de Patrice Lumumba à Winnie Mandela… Toutes ces vies imparfaites, certes. Mais mises à mal et en mille miettes. Toutes ces trajectoires achevées, échouées, définies par le pigment anthracite de leurs vies.
Je déteste Michael Jackson pour ce qu’il est devenu, mais je le remercie d’avoir fait vibrer la petite fille que j’étais. Je le déteste et je le remercie parce qu’il est peut-être possible d’être un monstre hideux et un modèle exemplaire. Ne sont-ils pas quelque part toujours un peu entre les deux, nos symboles, nos héros, nos repères?
Créer c’est une forme d’amour qui n’a pas de nom
Aujourd’hui, quand je m’observe créer, je vois mes lacunes, mes manques, mes déficiences. Je les exhibe à la vue de tous. Je les donne en offrande. Et espère transformer ces maux ordinaires en butin de guerre. Pour cela, j’ai tendance à demander plus, plus fort, plus vite, plus vrai. Ce désir d’intensité se traduit parfois par une férocité. Il m’arrive de grogner, presque de jouir. Je dirais que ça peut être mal interprété. Moi, je n’y vois que de l’amour. Mais quand on me regarde de l’autre côté, je conçois qu’on puisse y voir une certaine brutalité. Pourtant, je les aime, ces artistes qui se glissent dans la peau de mes œuvres. Cette forme d’amour n’a pas de nom. Un genre de désir qui s’abîme dans celles et ceux qui deviennent nos intuitions, devancent nos pensées, incarnent nos fantasmes. Il y a un mot à inventer pour cela. Et peut-être, ce mot pourra baliser la puissance de ce rapport profond, ambigu, inquiétant même, qui se dessine entre la créatrice que je suis et les interprètes qui me suivent.
Vlad
Il a un visage sur lequel est écrit tragédie. Et pourtant il est si drôle. Il traverse la vie avec son corps frêle dont se dégage une puissance inespérée. S’il fallait le manger, casser ses os, c’est dans sa moelle qu’on trouverait les nutriments pour s’en délecter. Il est comme ça. Il a emmagasiné au plus creux de lui tout le charisme dont j’aime me gaver.

Florence
À recommencer ma vie, j’essaierais de marcher dans les pas de Florence. Le nom d’une ville d’Italie. Un corps de la Renaissance. Rien de conservateur dans cette femme qui a fait le conservatoire. Deux fois. C’est une sensible machine. La tête dans la musique et les pieds dans ceux de Racine.

Anglesh
Il est comme un socle. Inamovible. Inébranlable plutôt. Comme une statue impossible à déboulonner. Un genre de grand sage avant l’âge. Je le connais depuis l’école. Et déjà, c’est lui qui m’enseignait.

Stacey
Je dis souvent d’elle que les fées se sont penchées sur son berceau. Peut-être parce qu’elle possède une beauté et une bonté qui n’appartiennent qu’au monde des enchantements et des divinations. Et pourtant, elle est si puissamment plantée sur terre qu’elle seule, avec sa lumière, peut danser avec son ombre.

Paul
Paul Chambers. Son nom évoque la Chambre des communes. La salle du conseil. Le conciliabule. Là où se trament les grands drames, là où se prennent les décisions. Et il y a quelque chose de cela chez lui, un désir d’aller au fond des choses, de percer les mystères, de voir clair. C’est pour ça qu’il pose sur nous ses lumières.